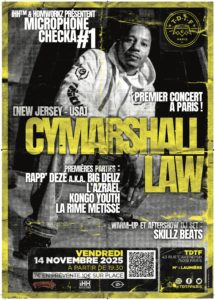iHH™ ARCHIVES : Sitou Koudadjé pour « Is That Jazz/Rap ? » [iHH #4]
On vous disait il y a peu tout le bien qu’on pensait du nouvel album de Sitou Koudadjé, « Chansons Cardiaques », dont iHH TM est partenaire et qui sera offert aux nouveaux abonnés qui le souhaitent. En avril 2016, dans notre numéro 4, nous avions publié une longue interview du poto pour son projet précédent, le très recommandé « Is That Jazz/Rap ? ». Nous vous ouvrons donc la boîte aux archives, histoire de faire plus ample connaissance avec « Monsieur 21 Grammes », rappeur de grand talent et crème d’humain, de ceux qui écrivent avec « le cœur, la folie et la liqueur » et tâchent de vivre debout « avant d’être regretté comme feu Big L ».
Si tu n’as pas trouvé ta place dans l’univers, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu peux le balancer à la face du monde, et essayer de le dire bien !
Dans ce que tu fais, il y a un côté vraiment « sans attitude ». Tu parles de la rue, de ce que tu y vis, mais tu n’as pas du tout une posture ghetto… Je me disais que ça avait peut-être un lien avec le bled…
SITOU KOUDADJÉ : Je suis parti au bled à la fin de l’adolescence, en 1999, j’y ai passé 2 ans. Je suis né et j’ai grandi en France, et là je suis passé de l’autre côté du miroir, de l’autre côté de l’équateur. Je marchais droit, après [rires] ! Et puis je suis d’un coin qui est assez rural aussi… Même si tu as des potos qui s’encanaillent, qui font des conneries, qui finissent au ballon, moi je ne me sens pas légitime dans un truc ghetto à tout prix. J’essaye de faire un truc qui me colle, tout simplement. Mon truc, c’est vraiment l’écriture, donc j’aime bien que ce soit relativement « bien écrit », si je puis me permettre, sans prétention là-dedans. Mais je vais jurer aussi parfois, avoir des propos un peu plus durs… On m’a déjà fait remarquer qu’il y avait cette dualité.
Tu ramènes toujours ton équipe dans tes projets, même si tu te définis comme solo. Sur « 21 Grams », il y a plein de featurings, et sur « Is That Jazz/Rap », il y a un posse cut de 10 minutes, avec toute ta bande qui défile ! Tu as beaucoup de phases aussi là-dessus : « si je disais que je me suis fait seul, je mentirais », ou : « la fois où je t’ ai dit que je me suis fait tout seul, je devais être rébou »…
S.K. : Je l’aime bien celle-là, parce qu’elle est très vraie. Des fois, tu galères à sortir les trucs, tu as pas forcément la reconnaissance que tu aimerais, et tu as tendance à penser et à clamer à qui veut l’entendre que personne ne tu a aidé, que tu as galéré… mais c’est vrai qu’en partie. Tu as toujours des copains. Dans mon nouveau morceau, je dis que j’ai les copains les plus extraordinaires du monde ! Tu as toujours des gens qui bougent. Même quand tu fais des scènes de merde, tu as des gens qui viennent pour donner du love. C’est mortel.
Tu peux expliquer un peu ton équipe ? Parce qu’il y a plein de blases, plein de gens qui apparaissent, et ce n’est pas forcément facile de s’y retrouver.
S.K. : Il y a un grand crew, « R.A.O Staff », ça veut dire « Rimes Anti Occidentales », de base. Ça a été initié par Alassane, c’est lui qui a ramené ce délire. Là, il est un peu en retrait, ce qui est très regrettable. Quand il était vraiment chaud, c’était hallucinant ! R.A.O, à la base, c’est un groupe dans lequel on était quatre : Menz, Mamasse, Alassane et moi. Après, ça s’est élargi, j’ai ramené « Dangereux Dinosaures », avec notamment Kofi Annani que j’ai connu en Afrique, et Lasmo. De fait, des affinités se sont créées, et on a fini par dire : « R.A.O Staff », le crew quoi. On traînait beaucoup ensemble, dans les bars de slam notamment, on a fait quelques morceaux, jusqu’à arriver à la mixtape « Le Peuple Parle Au Peuple ». Mais dans « R.A.O Staff », il y a aussi des mecs d’ailleurs, des mecs de Vernon – c’est une ville qui est après Mantes-La-Jolie, en Normandie – qui ont un petit crew qui s’appelle « Le Barrio » ; ils ont leur délire, leur identité par rapport à ce qu’ils vivent là-bas…
Comment tu décrirais ce qui vous rassemble dans la musique que vous faites ? J’ai l’impression que ce sont les lyrics, le souci du texte vraiment bien écrit. Mais aussi autre chose, pas facile à définir : ce n’est pas du rap « de lascars ». On sent des grosses affinités, autant lyricales qu’amicales.
S.K. : C’est l’humain qui est au départ de tout. Après, le ciment du groupe, c’est l’amour de la musique, tout simplement. Et puis on est curieux. Entre nous on va se filer des bouquins : « Vas-y, lis-ça ; moi j’ai lu ça ; tu devrais lire ça… ». Quand on est tombé dans Iceberg Slim [grand écrivain noir américain des années 1960, ancien mac et taulard – NDLR], la claque… On est des férus de culture et d’art, et on a poussé sur le terreau du peura en France où tu pouvais pas arriver et sortir direct un album chelou… Un texte ça doit être bien écrit. Sinon, ce n’est pas valable. Donc quand tu travailles en groupe, si tu n’es pas bon en cabine, tes mecs vont te dire de recommencer. Tu te rassois, tu écris un autre truc et tu recommences…
Mais… J’ai entendu « slam » tout à l’heure ? C’est quoi cette histoire [rires] ?!
S.K. : Pourquoi ? Vous avez quelque chose contre le slam ?
Quand le slam est arrivé, c’était un peu une tentative de rendre le rap « poli », quoi…
S.K. : En fait, c’est un pote à moi qui m’en a parlé, je ne connaissais pas, ça m’a interpellé, je suis parti me renseigner, et j’ai vu qu’il y avait plein de bars sur Paris qui faisaient des soirées slam… On était jeunes et en chien, ça faisait des ambiances pour bouger… En plus, le truc de bâtard dans le slam, c’est : « un texte, un verre » [rires]. Attends ! J’ai des cartons de textes, moi ! J’ai pas de gen-ar, mais j’ai du texte ! Et puis il y a des micros, tu rencontres du monde. On n’avait pas fait de projet encore à l’époque. C’était vraiment le moment où le slam est arrivé. C’était une belle expérience, on s’est mis bien. C’est un milieu aussi, avec ses bourgeois, etc. Toi, tu arrives comme rappeur, avec ta dégaine, on te regarde déjà chelou, alors au bout d’un moment ça nous a saoulés. Mais tu prends des claques quand même : tu tombes sur des mecs, des vieux babtous, limite avec la baguette sous le bras, qui te sortent des textes à tomber par terre !
L’écriture, c’est un état de grâce. Tu peux écrire vite ou moins vite, ce qui est important c’est ce qui va rester.
On parlait de dualité tout à l’heure. J’ai remarqué que tu freestylais beaucoup. Tu passes à « L’équipe De Nuit » [l’émission de Nes Pounta sur FPP 106,3 FM à Paname – NDLR] de temps en temps, tu tapes le freestyle dès qu’il y a une occase. Et pourtant, tu es de l’école de l’écriture hyper ciselée…
S.K. : Ce n’est pas incompatible ! Le freestyle, en l’occurrence l’improvisation, c’est de l’écriture, mais instantanée. Moi j’ai grandi en grande partie dans l’Essonne, à 40 bornes de Paris, mais je traînais tout le temps sur Paris, je ne suis pas très essonnien dans l’âme. Pour rentrer chez moi, il fallait une bonne heure de train. Pendant plusieurs années, je me posais au fond du wagon, avec ma conso, je me mettais du son, et je rappais pendant une heure, en impro ! Au bout d’un moment, tu commences à prendre un petit niveau…
« Pendant le trajet, je rêvais de percer, fier d’en être un ». Mais quand même, ce n’est pas tout à fait la même exigence, le freestyle et l’écriture…
S.K. : Si ! La seule différence, c’est qu’en freestyle, tu n’as pas de filet. Donc si tu es un peu trop bourré, tu bugges, tu te casses la gueule. Tandis qu’à l’écrit, tu peux raturer.
Mais si tu n’es pas assez bourré, tu n’y arrives pas non plus [rires] !
S.K. : On m’a déjà dit qu’il fallait atteindre l’ivresse sans produit… Parce qu’au bout d’un moment, tu ne peux plus encaisser. Bref, je tapais une heure de freestyle. À force, quand tu es bien chaud, c’est comme si tu écrivais. Tu te rends compte que tu dis pas forcément des conneries. Quand tu improvises, tu as souvent un gimmick au début, genre : « toi-même tu sais », pour te recaler. Mais quand ça fait 20 minutes que tu es en train de rapper non stop, tu es rôdé, ton cerveau va plus vite, et tu n’en as plus besoin.
Tu vois ça presque comme un truc de sportif ? L’entraînement en freestyle et le match en cabine ?
S.K. : Un peu. Mais l’écriture, c’est un état de grâce. Tu peux écrire vite ou moins vite, ce qui est important c’est ce qui va rester. Est-ce que ce qui va rester est pertinent, est-ce que c’est solide ? Quand tu es en train de faire c’est l’état de grâce. Ça peut durer 5 minutes ou des heures… c’est la folie !
C’est comme tu dis dans un texte : « J’écris avec le coeur, la folie et la liqueur . »
S.K. : Ouais [rires] ! C’est comme l’albatros de Baudelaire. C’est un oiseau, quand il est à terre et qu’il marche, il a une dégaine trop bizarre. Il est cheum, il marche chelou, tu te fous de sa gueule. Mais quand il vole, il est magnifique. L’artiste, c’est un peu ça. Quand tu es dans la vie de tous les jours, on va te dire : « regarde ta dégaine, comment tu es habillé, etc. ». Quand tu es dans l’art, les gens vont trouver ça mortel, ils vont vouloir être ton pote, ils te tapent sur l’épaule… Alors que la minute d’avant, ils te regardaient chelou, limite ils se foutaient de ta gueule ! Les trucs que tu vas dire dans la vie de tous les jours, on va les trouver chelou, et quand tu les mets en musique, on va te dire : « ouah, putain, c’est brillant ! », alors que c’est la même chose. C’est ta folie. C’est ton regard sur le monde.
Tu reviens souvent dans tes textes sur cette histoire de folie. À se demander si tu n’es pas un peu « borderline »…
S.K. : C’est un truc que je sens, mais j’arrive à tenir ! Soit tu es adapté à la société, soit pas. Quand tu deviens inadapté, on t’enferme physiquement ou chimiquement… donc je tiens ! Et la musique m’aide beaucoup.
Dans le morceau « Urbaine littérature » tu dis, d’ailleurs : « Musicale thérapie sur les bords de Seine / Jamais à cours de 16 / tant qu’y a de la 1664″… Ta conception de la musique, c’est ça ? Une façon de tenir debout, de rester normal le reste du temps ? C’est fort comme terme, « thérapie »…
S.K. : Au départ, ce n’est pas ça, au départ c’est un kif. Et puis au bout d’un moment, tu te rends compte que ça te fait du bien. Quand tu n’en fais pas pendant trop longtemps, tu commences à péter un câble. Tu ne fais pas forcément le lien, d’ailleurs. Puis tu te rends compte que ça fait un moment que tu n’as pas écrit, que tu n’es pas allé enregistrer, que tu n’as pas joué… Quand tu finis par le refaire, tu souffles, ça va mieux, tu es plus reposé. Certainement qu’il y a un truc thérapeutique, plus ou moins conscient.
Ta musique sent bien le défouloir ! « Thérapie », c’est peut-être dans le sens « thérapie de groupe », façon groupe de parole : « Bonjour, je m’appelle Sitou, je ne vais pas très bien, je vais vous expliquer pourquoi… » [rires].
S.K. : Un peu ! Après, c’est un choix de vie aussi. J’ai un taf balourd, j’aurais peut-être pu faire un truc mieux payé, mais ce taf-là me permet de réfléchir à mes morceaux quand j’y suis, me laisse du temps pour aller faire des scènes… Il y a une part de sacrifice, mais quand je passe dans ma partie son, je me fais plaisir. C’est pour ça aussi que je tape dur des fois dans ma musique, parce que c’est un sacrifice qui est un peu lourd… Ça me fait penser que je ne peux pas forcément faire écouter mes sons aux darons, parce que des fois, c’est un peu trop dur ! Si je fais écouter ça à ma daronne, elle va me dire : « Mais c’est quoi ton problème, ça va pas ? » [rires]
Revenons un peu à tes débuts. 1996, 1997, c’est quoi tes idoles, tes modèles, ton école dans le son ?
S.K. : Pas grand-chose. Je n’étais pas un mec qui avait tous les albums, parce que ça coûtait trop cher ! J’avais quelques trucs, des cassettes audio que les mecs me faisaient. C’est l’époque où Rocca arrive en solo, le premier Gyneco, Ärsenik… Le cainri, je n’écoutais pas trop, parce que je ne comprenais pas les textes. C’est un peu plus tard que je me suis mis au rap cainri, parce que j’avais des potes qui avaient de sacrées collections ! Mais à la base, c’était vraiment rap céfran, tout ce qui était mixtapes… J’aimais bien Case Nègre, un groupe du 20e arrondissement de Paris. Ça écrivait, et en même temps, il y avait une folie, une émulation de groupe. Pour autant, ça ne se la racontait pas. Ce n’était pas dans des postures caillera pour faire caillera. Je trouvais ça archi sincère, archi bien amené. Un groupe intéressant, déjà à cause du nom qu’ils ont choisi, et en plus ils envoient ça sérieux ! C’est une vraie référence pour moi.
Il y a justement Nokti de la Case Nègre en featuring sur « 21 Grams ». C’est comme si tu invitais une de tes idoles de jeunesse, alors ? Ou c’est quelqu’un que tu as croisé par la suite ?
S.K. : Même pas. Je l’ai pété sur Internet. Je l’ai sollicité, le mec a répondu présent. Ça s’est fait très simplement. Du coup, j’ai beaucoup de respect pour ces mecs-là, parce que tu les sollicites simplement et ils déboulent. Ça colle vraiment aux lyrics, à ce qu’ils disent. Je suis content de voir que ça continue pour eux, et si je peux leur donner un coup de main, je le fais aussi. Et le mec que tu vas solliciter, s’il accepte de poser avec toi, c’est que tu lui apportes quelque chose, c’est que ton projet est pertinent. Chacun prend sa part.
Il y a dans ton rap une grande recherche textuelle, de vocabulaire. Tu dis d’ailleurs dans un texte : « si tu veux me suivre, il te faut un parachute et un dictionnaire ». Ça veut dire que non seulement on va se jeter dans le vide, mais on va s’alourdir encore un peu plus avec un dictionnaire [rires] ?!
S.K. : Je l’aime bien moi aussi celle-là ! Tu vois, même face à la pseudo autorité, quand tu es dans la rue et que les keufs veulent te la mettre, si tu arrives à t’exprimer un petit peu, le mec va faire plus attention que si tu as du mal. Comme quand tu passes à la barre : les potos qui sont jugés et qui ne savent pas parler, c’est compliqué pour eux. Le mec qui a un peu de gouaille, tout de suite ça passe un peu mieux. Et peut-être qu’être un homme, ou une femme, c’est avoir un certain bagage. Après, tu as la culture scolaire, et tu as la culture que tu vas chercher toi-même. C’est important d’être curieux, dans tous les sens du terme. Il faut que tu t’intéresses aux gens, à la musique, il faut que tu ailles chercher. Si tu n’aimes pas lire, il y a des films… Mais il faut que tu sois curieux pour apporter quelque chose aux autres.
Des fois, quand on t’écoute, on est obligé d’aller chercher. C’est d’ailleurs souvent le peura qui te fait chercher d’abord, pas l’école ou les livres !
S.K. : Exactement. Si j’ai eu le bac, je pense que c’est grâce au peura ! On parlait de Lunatic tout à l’heure, des X.men, etc. : même si c’était street, dans des morceaux, ils te citaient des mecs, tu ne savais pas qui c’était. Petit, tu les entends te parler de Malcolm X ou de Farrakhan, « pour pas que les cailleras cannent », et tu te demandes : « C’est qui, Farrakhan ? »… Tu n’es même pas sûr que tu as bien compris, et puis un jour tu captes un docu et tu te dis : « Ah ouais, c’est lui Farrakhan, mortel ! » À partir de là, tu vas chercher, tu déclines l’information qu’on t’a donnée. Mais si ton rap est pauvre, il n’y a rien à décliner ! Donc même si ce n’est pas forcément volontaire, c’est pour ça que je balance des références. C’est mon école. Tu cites des trucs, ceux qui connaissent vont percuter direct. Et ceux qui ne connaissent pas, ça va peut-être les amener à quelque chose. Ce que tu prends, tu le mâches, tu l’ingurgites, tu le digères et tu le recraches… C’est l’univers qui est comme ça !
Il faut que tu t’intéresses aux gens, à la musique, il faut que tu ailles chercher. Si tu n’aimes pas lire, il y a des films… Mais il faut que tu sois curieux pour apporter quelque chose aux autres.
Tu n’as pas peur que ce vocabulaire très étendu et ces références multiples puissent mettre à distance, qu’on prenne ça pour du « rap intello » ?
S.K. : Je vois ce que tu veux dire. En plus, je trouve ça plus fort d’arriver à dire des trucs puissants avec des mots simples que d’avoir des mots compliqués. J’aimerais bien tendre à simplifier la forme, arriver à dire la même chose avec des mots plus simples, que tout le monde puisse comprendre. J’en ai trop dans la tête je pense… Même quand je te parle, je vais te sortir des mots chelou [rires] ! J’ai trop de bordel qui se tape dans ma tête, et du coup, je n’arrive pas à simplifier. Pour l’instant…
Ton premier album, « 21 Grams », est très construit, avec des interludes, des samples de films, une fausse émission de radio qui sert de fil conducteur… C’est une volonté calculée ? Il y a même un morceau caché !
S.K. : Deux ! Comme ça, ça fait 21 morceaux… Pour moi, un album c’était ça. J’ai juste essayé de faire de mon mieux, sans forcément calculer, mais pour moi, c’est logique que ce soit comme ça, franchement. Un bon album, ça doit être sans prétention. Du coup, je me suis fait plaisir. C’est pour les albums à venir que c’est plus compliqué. Tu as déjà fait ça, comment tu vas revenir ?
Les featurings, c’est surtout des gens de ton équipe, on sent que tu n’as pas appelé des gens pour buzzer, pour avoir des gros blases.
S.K. : Il y a Nokti, Dangereux Dinosaures, Alassane de R.A.O, Joe Lucazz… Lui, c’est parce qu’on a des potes en commun. C’est un mec qui a son histoire, qui l’assume, et qui n’en joue pas des masses. Je l’ai appelé pour faire un morceau, le mec est venu au stud’, on n’a pas pu enregistrer ce jour-là, et il est revenu quand même plus tard. Respect. Et puis j’aime beaucoup, c’est vraiment de l’écriture, donc je me régale. Quand les instrus sont bien choisis, ça fait mouche direct, parce que le mec sait vraiment écrire.
Je t’ai entendu en interview dire que tu avais appelé cet album « 21 Grams » parce que tu voulais faire de la musique de l’âme, comme les bluesmen. Tu dis très joliment que tu es sur « la même ligne horizontale » qu’eux, parce que ce sont des gens qui étaient très déconsidérés à l’époque, qui étaient des cailleras, comme pour le rap aujourd’hui : une musique faite par des gens qui ne sont pas légitimes pour faire de l’art et qui pourtant produisent une musique dont on dira dans 50 ou 100 ans que c’est de l’art ! Tu as même un interlude sur Van Gogh . Tu t’identifies, ou… [rires] ?
S.K. : L’interlude est tirée du film « Basquiat », mais je ne m’identifie pas à lui… Je kiffe la peinture, les toiles, et je trouve que le travail du MC et celui du peintre, c’est un peu la même chose. C’est un travail ingrat, qui est long, tu as pas forcément la reconnaissance que tu aimerais, des fois tu crèves dans la misère la plus totale, comme dans « La Bohème » d’Aznavour. Ton succès, lui, te survit. Donc je trouve ça édifiant par rapport à la réalité de l’artiste, du musicien, et du mec qui fait du peura.
Tu dis même au début d’un morceau : « Je suis pas une caillera, je suis un artiste ». On trouve beaucoup de références à cette histoire d’artiste…
S.K. : Ça doit être un besoin de reconnaissance, plus ou moins conscient ! Tout à l’heure, je te disais que j’ai un taf de merde, mais qu’à côté, t’inquiète, j’envoie ! Tout être humain a besoin de reconnaissance, a besoin que tu le regardes, que tu le valorises, que tu lui dises : « ouais, tu es mon semblable ». L’artiste a un énorme besoin de reconnaissance, mais à l’instar de tout humain, il a besoin de love et qu’on le regarde, tout simplement.
Je pense qu’on est tous des artistes. Il y a juste des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont faits. On doit tous trouver notre place dans ce putain d’univers.
Mais comment tu définis un « artiste » ?
S.K. : Pour moi on est tous des artistes.
Mais tout le monde ne se définit pas comme tel. Toi si.
S.K. : Oui, parce que j’ai évolué… Je sors de chez moi, je vais en studio, c’est mon mode de vie. Mais je pense qu’on est tous des artistes. Il y a juste des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont faits. On doit tous trouver notre place dans ce putain d’univers. On a tous une place. Dans mon nouveau morceau, je dis : « Je parle de nombre d’or et de boson de Higgs » ! Je kiffe les trucs astrophysiques [rires] ! Toute chose est forcément composée de cordes, ou d’atomes. En fonction de comment ils se placent, ça va te faire un être humain, un mur, un soleil, une terre… Donc de la même manière que les atomes ont une place précise, ou l’ADN qui construit un être humain, tout le monde a une place. Si tu rapportes ça à l’échelle sociale, tout être humain a quelque chose à apporter. Tout le monde est un artiste ! Le mec qui est peintre en bâtiment, on va lui demander de repeindre la pièce : toi, tu vas faire la même chose, tu regardes bien ce qu’il fait, tu prends le truc de la même façon, et non ! Tu pars de travers ! Le mec, c’est un artiste dans son truc. De même que le mécano, de même que la daronne qui fait les ménages. Moi, j’ai fait les ménages. Les daronnes, elles m’ont montré : « tu fais comme ça, tac-tac ». Tu passes derrière, pour toi c’est un truc de ouf, et elles, elles sont déjà au bout du couloir quand toi, tu n’es même pas encore sorti de la pièce, c’est quoi le délire ? Chacun est artiste dans son truc. Je dis dans un autre lyrics que dans ce monde imbécile, les lauriers ne sont pas attribués au mérite, à la vraie valeur des gens. Ce sont les gens qui font les tafs les plus pénibles qui devraient être payés le plus.
Je voudrais revenir sur cette histoire de « ligne horizontale », qui relie pour toi les bluesmen américains de la fin du XIXe et les rappeurs. Comment ça te vient cette conscience-là ?
S.K. : Pour moi, c’est en lisant des bouquins… C’est comme a dit Renaud : l’important c’est l’amour des livres, avec lesquels tu peux faire le tour de l’humanité sans bouger. C’est ça : tu lis des bouquins, tu voyages. J’ai lu des trucs comme « Le Peuple Du Blues » de Leroi Jones. Tu y trouves une communauté de réalité, de vécu, qui te touche, et tu te dis qu’en fait tu fais la même chose qu’eux. On nous tape sur la gueule de la même façon, avec quelques nuances, mais c’est un peu pareil.
Robert Johnson, un des premiers bluesmen, c’est un type qui traînait dans les bars, qui zonait avec les putes, qui se droguait, qui était vagabond… C’était le pire des parias, un type que les Blancs rêvaient de tuer, et maintenant, on en fait l’inventeur du rock & roll !
S.K. : Bah ouais, c’est ouf… Comme Van Gogh ! Après, lui, c’est une icône, donc c’est facile de le citer. Ce n’est pas la même quand tu parles de Robert Johnson, et de tous les autres qu’on ne connaît pas forcément – parce que peut-être avec lui, il y avait un type qui était plus chaud encore et qu’on a oublié… Tu as beaucoup d’appelés et peu d’élus. Dans le peura, comme dans autre chose. Il faut être mesuré dans ses ambitions, mais ce qui est certain c’est que c’est la suite logique du truc. Pour moi c’est exactement la même chose.
Tu viens de sortir un nouvel album intitulé « Is That Jazz/Rap ? J’ai trouvé ce titre dommage, au départ. « 21 Grams », c’était très clair : « Je vais te parler de moi, je vais te dire ce qui m’habite ». Là, c’est comme si tu décalais le truc, et que tu proposais un album concept, à la limite…
S.K. : Bah, c’est un album concept, en fait ! La genèse de ce projet, c’est que je suis parti chez mon pote Greg Mo pour lui demander des instrus. Il ouvre un fichier, j’écoute un ou deux sons, je trouve ça pas mal, il me dit qu’il n’a samplé que des trucs de jazz. Pour un mec qui n’aime pas ça… Il avait dix sons, je lui ai dit : « je prends les dix, et on a un album ! » C’est un projet commun, c’est pour ça que nos deux blases sont écrits à la même taille sur le skeud, question de respect. Après, c’est comme quand tu es petit, en arts plastiques, quand le prof te dit : « le dessin d’aujourd’hui, vous ne le faîtes qu’au stylo à bille ». Je ne pouvais pas prendre un queur-ma ou des crayons de couleur. J’étais coincé. Je n’avais que ces instrus, et il fallait que je m’y tienne.
Tu as écrit dessus ?
S.K. : Non, je n’écris pas forcément sur les instrus. Je vais souvent mettre de la soul ou du rap cainri, ou pas de musique du tout. Parce que les instrus me saoulent vite, en fait. Je t’ai dit, c’est un moment de grâce, donc je me mets dans mon ambiance, je me mets un son que j’aime bien, et je reviens de temps en temps sur l’instru pour voir si ça colle ou pas, et si ça rentre bien je mets de côté. Les deux premières, ça allait tout seul. Après, il y avait d’autres instrus moins faciles à travailler pour moi, mais comme je m’étais fixé ce challenge-là, il fallait que je termine. C’est un truc de compétiteur. Dès que j’ai fini « 21 Grams » je me suis mis dessus. Le CD n’était même pas encore pressé… J’ai fait ça en mode footing de décrassage. Ça m’a pris deux piges.
Dans le livret, il y a quelques lignes de présentation pour chaque titre. Pourquoi tu t’es senti obligé d’expliquer chaque morceau, alors que dans l’album précédent tu disais : « je lâche le truc, après ça me regarde plus », ou : « que comprenne celui qui peut » ?
S.K. : Je ne me suis pas senti « obligé ». J’aime écrire. De la même façon que je suis content d’être avec vous et de pouvoir répondre à quelques questions, d’éclairer les oeuvres… Le truc, c’est que c’est plus cher avec un livret dans lequel il y a tous les lyrics. Je pense ça mériterait d’être fait, parce que certains lyrics sont difficiles à comprendre. Mais c’est plus d’oseille, donc c’est une alternative. Je mets quelques lignes pour expliquer les morceaux, et je kiffe le faire. « Je lâche le truc, après ça me regarde plus », c’est pour dire que quand tu écris le truc, tu ne sais jamais comment ça va être perçu. Donc même mes explications, je ne sais pas comment elles vont être perçues ! Mais c’est un exercice que j’aime bien : quand tout est finalisé, que la pochette est prête, je me pose. Ça me permet aussi de parler au mec qui va pécho le CD. Un peu comme la cassette audio que Mesrine envoie à sa meuf, quand il lui dit : « si tu écoutes ça, c’est que je suis mort ». Je ne suis plus là, c’est toi qui as le truc. Ça me regarde plus, mais je te laisse une dernière trace.
La pochette de l’album, c’est un crâne aux rayons X. L’album précédent, c’est une photo de ton âme, et là c’est une radio de ton crâne… Ce qui est sûr, c’est que tout ça se passe dans la tête [rires] ! Et dans le crâne radiographié, on voit deux squelettes en train de… copuler !
S.K. : L’image m’est apparue… C’est encore un truc d’artiste, de folie… J’ai vu l’image. Je me suis dit : « c’est ça la pochette » ! Crâne, radio, un couple dedans… C’est en rapport avec le titre, « Is that jazz ? » Ça aurait pu être : « Is that funk ? »
À cause de l’origine du mot ?
S.K. : Oui. On ne connaît pas exactement l’origine du truc, mais ce sont des mots qui auraient une connotation fortement sexuelle. « Jazz », c’est pour décrire des comportements sordides, des gens de basse extraction, etc. Quand je dis : « Is that jazz ? », c’est une phase à plusieurs entrées. Je reprends un truc de Gil Scott-Heron, et en l’associant à cette image, on se demande si c’est vraiment en mode caillera, genre : « on a tous une bite dans la tête, basta », ou si en allant chercher derrière, il n’y aurait pas un truc joli. Est-ce que ces gens-là ne seraient pas capables aussi, quelque part ? C’est juste ça. À l’instar du titre, l’image est plus une interrogation qu’un fait.
Il y a une thématique autour de laquelle tu tournes beaucoup, c’est l’amour des femmes. Je trouve que tu as une manière très particulière d’en parler. Ça revient beaucoup, c’est charnel, mais on sent que c’est respectueux. Tu assumes ce que tu aimes dans la vie, mais c’est fait proprement. Il n’y a pas beaucoup de keumés qui parlent de « cul » sans parler mal des meufs. Toi tu parles de tes sœurs, de tes égales.
S.K. : On ne m’a pas toujours dit ça ! C’est le premier retour dont je me souvienne qui est plus ou moins positif là-dessus ! Souvent, c’est plutôt : « Pourquoi tu dis ça ? ». C’est pour ça aussi que j’ai du mal à faire écouter aux darons… Après, je me fais plaisir, même si, bien sûr, tu vas t’autocensurer. Je parle de ce que je veux. Je vais aussi égratigner des gens… Ça me fait penser à une phase de mon collègue Koffi qui dit : « Ceux que je laisse tranquille dans la vie, je les bousille dans mes textes ». Il y a des textes, je ne peux pas les faire écouter à la daronne. J’étais au bled, avec ma tante, le CD tournait, je me disais : « Ah non, putain, pas ça, pas ça… » [rires] ! Mais ça me ressemble… Après, comme je te dis, ce sont des photographies. C’est une certaine période de ma vie. Ça fait du bien de le dire ! On ne se voit pas marcher, donc je ne me rends pas forcément compte que c’est hyper présent dans ce que je raconte.
Par contre, tu ne parles pas du tout de culture hip-hop dans tes textes. La danse, le graff… Est-ce que tu te sens faire partie de ça ?
S.K. : Oui, je me sens en faire partie, mais je ne suis pas un gardien du temple. Quand j’étais jeune, les mecs qui étaient hip-hop, ils avaient toutes les sapes… Ça coûtait cher, donc je n’étais pas dans ce délire-là, j’étais déjà à part. Après c’est ma, et notre, culture. J’aime bien le graff, surtout. La peinture. La danse, c’est kiffant, mais je suis très difficile. Pour moi, c’est naturel, même si je suis plus du côté peura. Ce que je regrette, c’est qu’il n’y ait plus de ponts entre les disciplines. C’est le peura qui a tout pris, en gros. C’est le capitalisme qui a niqué le délire. S’il y avait eu plus d’argent injecté dans la peinture, les autres seraient en retrait. Le rap, ça a marché, les gens ont acheté des skeuds, donc ça a pris le pas. Mais en vérité, tu ne peux pas l’enlever. C’est notre culture, c’est nous. Comme les punks ont la leur. Et nos enfants en hériteront. Même les petits jeunes qui font leur truc, ils ne peuvent pas l’enlever, le gueta, la danse, le b-boying, le dee-jaying… C’est là, ça fait partie du truc. De la même façon que dans le rap ou d’autres musiques, tu as des mecs qui vont être connus et d’autres pas, ça ne veut pas dire que le mec qui n’est pas connu n’est pas fort.
Je connais des rappeurs de ouf, qui ont décroché parce que les aléas de la vie font que, et je me rends compte que ça les rend fiers que je continue, que j’arrive à sortir des bordels, qu’ils soient distribués, que des gens les écoutent.
Même si tu ne te dis pas gardien du temple, tu continues à proposer une musique qui est très marquée par certaines années… Tu as même sorti un sticker avec un texte qui commence par « Sitou ne rappe pas à la bonne époque » !
S.K. : C’est ce qu’on m’a dit ! J’ai trouvé la critique pertinente, je l’ai reprise exprès ! Je pense que ça me définit bien… Le mec qui ne connaît pas va capter direct. On ne se voit pas marcher, donc prendre la vision de quelqu’un d’autre qui me définit en peu de mots, ça m’a fait kiffer. Après, moi j’aime juste les bons instrus. Si tu me sors un instru trap qui cartonne, vas-y, c’est bon. Je ne l’ai pas fait parce qu’on ne m’en a pas proposé !
On a déjà un peu parlé du pourquoi tu rappes, de ce que tu y mets. Mais pour qui tu rappes ?
S.K. : Pour l’univers entier ! Je te sors une réponse à la con… mais pas tant que ça [rires] ! Tu sais, « Sounds Of Earth », le délire d’ envoyer un skeud dans l’univers avec les bruits de la terre, c’est un peu ça. Parce que tout est musique, et tout est mathématique… Mais bon, si je ferme la parenthèse à la con, un de mes réels moteurs, ce sont mes potos. On était beaucoup au départ, il y avait une école, R.A.O, Dangereux Di… Tous les potos, les mecs du 77, de Roissy, de tous les coins où je galérais, les coins de Paname, mes gars du 11/80 [91]… Tout à l’heure, hors entretien, tu me parlais d’une phase où je citais Zesau : « Y a beaucoup de visages dans un morceau ». C’est ça. Donc c’est pour tous les potos. Je connais des rappeurs de ouf, qui ont décroché parce que les aléas de la vie font que, et je me rends compte que ça les rend fiers que je continue, que j’arrive à sortir des bordels, qu’ils soient distribués, que des gens les écoutent. Donc c’est en grande partie pour les copains, et un petit peu pour moi aussi…
Mais la réception, le succès, les ventes, la notoriété, la reconnaissance…
S.K. : C’est là, mais c’est relou ! Parce qu’après, ça devient de l’aliénation. Quand tu mets un orteil dedans, tu changes, tu as d’autres impératifs. Quand ça devient ton métier, ce qui paye ton loyer et ce qui remplit le frigo, quand tu dois faire des couplets pour remplir ta gamelle, c’est autre chose. C’est un luxe de ne pas vivre de ça, de travailler, d’avoir un taf alimentaire d’un côté, et de péra de l’autre. Les gens pensent l’inverse, mais ils ne se rendent pas compte. Le vrai luxe, c’est d’en être détaché. Quand tu as des impératifs, tu ne fais plus la même musique. Bosser à côté, ça me permet de taper comme je veux dans ma musique, je peux dire ce que je veux. Artistiquement c’est un luxe. Quand tu es signé, tu es artiste. Tu es sur ton siège d’artiste, comme sur les plateaux de cinéma, tu as ton attaché de presse, ton manager, le mec de la distrib’… tu es dans une machine. D’un côté, c’est cool, mais ça fait autant de mecs qui viennent te dire : « Mais qu’est-ce que tu as voulu dire ? Pourquoi ? ». Autant de regards, autant de retours. Alors que tout seul, avec ton taf, tu mets tes billes pour faire ton studio, il n’y a personne pour te dire quoi que ce soit. Tu dis ce que tu veux. C’est ce que les petits, qui font tous de la trap – et c’est même pas une histoire de trap, il faut arrêter avec ça, c’est juste qu’ils font tous la même chanson –, ne captent pas. C’est dommage de tous faire la même ! Si tu mets les billes pour ton studio, tu peux faire ce que tu veux ! Ce n’est pas ta daronne qui va te dire quoi que ce soit, elle n’est pas là ! Ce n’est pas ton patron qui va te dire : « nanani », parce que tu as badgé, tu as fait tes heures, c’est fini. Tu fais ce que tu veux ! C’est à toi d’être curieux et de proposer des trucs intéressants. Si tu n’as pas trouvé ta place dans l’univers, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu peux le balancer à la face du monde, et essayer de le dire bien !
Tu dégages une grande humilité dans ce que tu fais… Presque une timidité, même sur scène. La plupart des rappeurs sont des grands timides !
S.K. : La plupart des artistes, même. C’est ce qui fait que tu as une sensibilité, qui va te permettre de voir des trucs, des trucs chelou, dont les gens vont te dire : « Mais vas-y, qu’est-ce que tu me racontes ? », mais qu’ils vont trouver mortel quand tu les mets en scène…
La tise c’est un peu la même chose.
S.K. : Oui, grands timides, grands alcooliques… Je vais te parler sous tise ou normal, ça ne va pas être la même… Enfin, c’est la même personne, mais la tise, ça désinhibe. Casey parle de sa grande timidité dans ses lyrics, et pour l’avoir croisée quelques fois, c’est vrai qu’elle est calme dans la vie, Casey ! Mais quand tu la vois sur scène c’est un délire ! En psychiatrie, notamment, on utilise ça. On fait dessiner, écrire, faire du sport, parce que c’est une thérapie !
« Toujours politisé, comme un pamphlet de Fanon la famille » : Tu ne fais pas du « rap conscient », tu ne fais pas du rap militant, tu es plus dans l’introspection. Mais pour autant, il y a une conscience qui transpire à chaque lyrics, sans jamais affirmer clairement des opinions tranchées.
S.K. : Oui, je trouve ça plus légitime. J’ai du mal avec le militantisme. Après, j’ai plein de potes qui bougent, et je regarde ce qu’ils font, et je soutiens, mais je trouve ça plus légitime de faire de cette façon-là que d’arriver en portant une bannière. Parce que tu te fais baiser ! Moi, je préfère être du côté des petits, qui se font tout le temps baiser, que de prendre la carte d’untel un jour et de dire le lendemain : « je me suis fait baiser », pour ensuite aller de l’autre côté et que ce soit la même…
Mais comment tu définis ton rap, alors ?
S.K. : Ce que je fais, ce n’est pas du rap, c’est du jazz ! C’est du blues [rires] ! Je chante la souffrance. Je trouve ça plus légitime de me présenter : « je suis ce monsieur, je suis né là, j’ai grandi là, je mourrai je ne sais où », plutôt que d’affirmer des grandes vérités.
Pourtant tu invites Skalpel, du groupe Première ligne, qui est un des rappeurs militants les plus actifs, et tu joues souvent dans des concerts de soutien…
S.K. : Comme je t’ai dit, j’ai des potos, je respecte grave ce qu’ils font, et je pense que c’est réciproque. Pour moi, ce n’est pas incompatible. C’est de l’humain avant tout. Skalpel, il fait son shit, et moi je kiffe son shit ! C’est pas pour autant que je vais me mettre à côté en prenant une bannière, moi je reste dans mon délire. Lui, je valide ce qu’il fait, donc je lui dis : « viens, frère » ! Et si on me sollicite, je viens. Je peux aller n’importe où. La fête du tiéquar, tu m’invites, je viens ! Le concert des frères Kamara par exemple [Abderrahmane et Adama Kamara, condamnés sans preuves et essentiellement sur la base de témoignages anonymes rémunérés en 2010 puis en appel en 2011 à des peines de 15 et 12 ans de prison pour un guet-apens contre la police pendant les émeutes de Villiers-Le-Bel – NDLR], là c’est normal ! Mais porter une bannière, non. J’attends que ça pète, et après on se débrouille, on voit ce qu’on peut faire.
Ce que je fais, ce n’est pas du rap, c’est du jazz ! C’est du blues ! Je chante la souffrance !
Tu affirmes quand même souvent une conscience noire : « la science de l’homme blanc, la patience de l’homme noir », « quand les africains ont arrêté de sourire »…
S.K. : Oui, j’y pensais justement… J’ai des potes qui sont en mode « black black ». Mais frère, au bout d’un moment, black c’est bien, mais il y a des renois qui sont des enculés, et des babtous pareil ! Et il y a d’autres babtous, ce sont des frelos. Ce n’est pas une question de couleur. C’est une question de coeur. Tu sais, si le peura a pété comme ça, c’est parce qu’il y a des geois-bour qui sont venus, qui ont kiffé le délire, et ils avaient les connaissances, le bif, les infrastructures, le savoir-faire pour travailler le truc. Si c’est que des mecs du ghetto, au bout d’un moment, ça retombe à plat. Il a fallu que ces gens s’accoquinent, il a fallu l’alchimie des deux. Ce n’est pas seulement une question de couleur, de classe, de genre. Et puis, comme dit Despo, il y a toujours des mecs d’en bas, si tu viens en métro ils vont te dire : « t’as pas de gamos, tu es sérieux khey ? », et si tu viens en gamos, ta voiture, ils te la rayent [rires] !
Interview : MaNu et Kasko
Photo : EBEN SCAR
La version longue de cet entretien est en écoute dans la spéciale de Black Mirror.
Pour télécharger la version magazine :