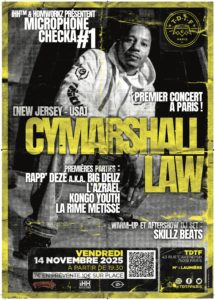Sourire, rêves et vinyles : L’interview de Logilo, maître des platines
Logilo est un artiste à plusieurs casquettes. Vice-champion de France de DJ DMC en 1988, il a pendant des dizaines d’années voué son quotidien à la musique. À 52 ans, Logilo passe aujourd’hui le plus clair de son temps en studio, en tant que manager et beatmaker pour soutenir les projets d’autres artistes. Rencontre au Studio Capitole de Toulouse avec le « Tonton ».
Interview par : Nicolas Sadourny
Pourquoi t’es tu lancé dans le mixage, la prod en plus d’être DJ ? d’où te vient cet intérêt ?
Au départ j’étais vraiment dans le djing, mais j’ai toujours eu cette idée d’être décathlonien. C’est à dire avoir plusieurs compétences. C’est très bête mais l’idée est qu’ à chaque période de ma vie, je me suis essayé à ce que je trouvais cool. Donc j’étais DJ au début, puis je me suis au beatmaking à la fin des années 80.
On te qualifie de beaucoup de termes : DJ, ingénieur du son, producteur, mixeur, scratcheur… toi tu te définirais comment ?
J’aime vraiment bien cette définition de clown (rires parce qu’on est là finalement pour créer du divertissement, pour accompagner les gens dans un quotidien qui est aujourd’hui d’autant plus morose. Et puis, si j’ai choisi de me comporter comme un clown, c’est aussi pour ambiancer ma vie. Tiens ! j’ai fait une blague sur Facebook il y a deux jours en postant « J’ai envoyé un mail aux années 90 : J’ai gardé le sourire alors rendez moi mes cheveux ! » Tu vois je suis quelqu’un de souriant, je kiffe.
Est-ce tu saurais définir ton style ?
C’est vachement compliqué. Certains me connaissent en tant que DJ, d’autres en tant que beatmaker. On me dit parfois en écoutant mes sons « Tiens ça ressemble à ça ». Aujourd’hui j’ai plutôt l’impression de servir des projets, par exemple si je travaille sous la marque Logilo, je travaille avec le style Logilo, c’est à dire des sons plutôt boom bap qui sont classifiés à une époque. Après quand je vais intervenir en tant que réal par exemple je vais penser différemment pour mettre le projet en valeur.
Tu te vois comme un grand bosseur ?
J’ai pas vraiment le sentiment de bosser. Je suis fils d’ouvrier et j’ai vu ce que c’est que de travailler dur. Au sens social du terme j’ai jamais eu le sentiment de travailler. J’ai dû faire des sacrifices évidemment pour mes objectifs, et la précarité dans mon milieu est très forte. Mais j’aime tellement ce que je fais que je le vois pas comme du travail, et pourtant ça occupe presque toute ma vie. Pour moi une petite journée de taff c’est 12 heures, et une bonne journée c’est 18 heures. Après je rentre chez moi, je dors et c’est reparti. Au final la seule chose importante pour tenir un rythme comme si on a l’envie c’est la santé. Et la santé pour moi ça veut dire zéro drogue et zéro alcool. Ça m’arrive de fumer des cigarettes mais rien d’autres.
En tant qu’artiste, est-ce que tu sens plus attiré par les grands festivals de musique ou bien par les scènes underground plus discrètes ?
Les deux. Les deux sont très importants parce que tout le monde a besoin de se projeter, de se mettre devant un public. Après selon moi c’est beaucoup plus facile d’être bon devant 5000 personnes que 200. Si t’es dans une salle à petite capacité avec 200 spécialistes, t’as intérêt à être haut level. Les énergies sont très différentes selon les audiences, la proximité avec ceux qui écoutent change beaucoup de choses au jeu de l’artiste.
Est ce qu’il y a une raison particulière pour laquelle tu as ton studio à Toulouse ?
Plusieurs raisons. Déjà c’est proche de l’Espagne qui est mon pays d’origine et que j’aime beaucoup. Ensuite le temps y est bien meilleur qu’à Paris et je déteste le froid ! Et au final, c’est un pote qui m’a proposé de passer par Toulouse avec ma femme, alors on est venus, on a visité et on s’est dit « Hé mais c’est bien ici. Allez on emménage ? » (rires) Ça doit paraître fou mais c’est comme ça que ça s’est passé ! Alors on est resté sans aucun regrets. J’ai grandi dans la banlieue parisienne, c’est toute mon enfance. Mais tu me donnerais 50K par mois, je reviendrais quand même pas vivre dans la capitale.
En cette époque de crise à cause du Covid, comment ton travail a-t-il été impacté ?
Le premier confinement a été terrible. On avait un lieu où 80 groupes et artistes passaient chaque année, c’était un vrai travail de terrain quotidien, et ça s’est arrêté d’un coup. Et pour la première fois depuis des années j’ai arrêté les machines. J’ai fait des activités, Netflix, musique, jardinage… Ce que je pouvais quoi. Pour le deuxième confinement, on a pu continuer à travailler sur certaines tranches horaires.

Y a-t-il un artiste avec lequel tu travailles régulièrement ?
Surtout des musiciens. On a créé un groupe, les Supersoul Brothers avec une dizaine de musiciens, basse, trompette, guitare, batterie… on a fait 85 séances de répétition, 50 concerts en trois ans, c’était incroyable. On a mis en stand-by parce que c’était compliqué, mais je vous annonce qu’on repart bientôt pour un tour ! On est en train de monter un label alors que j’avais dit « Plus jamais ça ! » mais aujourd’hui on a l’envie et on va s’éclater.
Comment choisis-tu les artistes avec lesquels tu collabores ? C’est plutôt les autres qui viennent te proposer des collaborations ou bien toi qui vas à leur rencontre ?
C’est souvent les artistes qui viennent me voir, et parfois j’ai des coups de coeur. Ce qui m’intéresse c’est de voir si le jeune a une vision. Et des fois ils en ont une mais ils l’ont pas encore verbalisé, et mon travail ça va être de l’aider à le faire. C’est plus ou moins compliqué, parce que certains jeunes artistes manquent beaucoup de connaissances « rapologiques », donc ils sont dans le flou.
Tu as mixé plusieurs fois à l’étranger ?
Oui surtout en Espagne. J’ai pu remarquer qu’il y avait des codes musicaux qui vont plus ou moins marcher selon les cultures. Pas forcément dans l’instrumentalisation, mais plutôt dans la construction de personnage. Il y a parfois des séparations locales, régionales qui vont changer la lecture qu’aura un public lors d’un concert par exemple. Mais il y a des choses intemporelles. Les musiques groovy, ça marchera quelque soit l’endroit et le temps.
Quelle est ton oeuvre favorite ?
Mon album de chevet c’est Gratitude par Earth, Wind & Fire. C’est juste incroyable, Maurice White il avait tout compris. On a été bercé par ces sons, quand on écoute on a l’impression que c’est pré-enregistré tellement c’est parfait, mais c’est juste qu’ils ont une énergie phénoménale. Moi je peux pas rejouer leurs morceaux, c’est juste trop.
« Les jeunes, n’écoutez personne et faites vos trucs ! »
Est-ce que tu ressens un manque d’originalité dans le rap aujourd’hui? Ou bien au contraire tu continues d’être surpris ?
La symbolique a changé. Le problème n’est pas que les jeunes sont en manque d’idées, mais plutôt je pense qu’on est sur un raisonnement de « Pas de prise de risques ». On évite de faire quelque chose parce que selon la tendance ça marchera sans doute pas. Et c’est ça qu’il faut changer, on doit pouvoir essayer des choses, même si ça risque de ne pas marcher. Les jeunes, n’écoutez personne et faites vos trucs !
Avec le temps, ta vision du djing a-t-elle changé ? C’est-à-dire ta manière de travailler, de composer…
Moi dès le début des années 90, j’utilisais des machines pour les samples et je voyais simplement l’apport que ces appareils apportaient. Donc personnellement ça ne m’a jamais gêné, j’utilise les outils qui me plaisent. L’élément old-school que je changerai jamais par contre c’est le vinyle. Le ressenti, le toucher, les sensations… c’est inégalable. Quand on travaille avec, on se sent comme des artisans.
Avec du recul, que penses-tu de ta longue carrière ?
Elle est très bizarre. Mon père bossait dans un camion, moi je bosse dans un studio. Je me suis lancé à 18 ans parce que je me disait que les métiers autour de moi me plaisaient pas, je travaille dur chaque jour en ayant le plaisir de me lever et de me coucher à l’heure que je veux. Je fais partie des gens très chanceux qui avaient des rêves étant gamin, et qui plus tard les vivent. La vie, elle m’a gâté.
Est-ce que tu en vois le bout ou c’est loin d’être fini ?
Je croyais que c’était fini il y 15 ans déjà. Je croyais être en train de changer, de partir du milieu. Mais en fait non, il y a toujours quelque chose qui venait me mettre un coup de pied et je repartais à fond. Et c’est pareil aujourd’hui. L’envie revient toujours.
Quand tu écoutes ce que font les jeunes aujourd’hui, tu te dis que la relève est assurée ?
Bien sûr. je dirais même que LES relèves sont assurées, parce qu’il y a plusieurs jeunesses avec différents regards. Mais artistiquement c’est dingue, je le vois aussi à travers mes enfants. Mais je vois aussi une sorte de tristesse collective. Et contre ça il faut chanter, il faut lire, il faut écrire, il faut s’amuser, il faut s’exprimer. Alors évidemment dans cette industrie il n’y a pas la même place pour tout le monde, mais chacun peut essayer de faire sa petite place au soleil comme il peut, à sa façon.
Tu as une réputation de figure paternelle dans le milieu du djing, on t’appelle Tonton Logilo. Cette image te plaît ?
Ah grave. Bientôt ce sera Papi Logilo, et ce sera toujours génial.
As-tu un rêve, un objectif qui te fait avancer ?
Oui. Je crois que suis en train de mettre les pieds dedans en ce moment avec la création de label. Plus largement, je rêve de faire le pont entre nous les artistes et les amoureux de musique. Ceux qui le soir rentrent chez eux, lancent un vinyle, s’assoient dans leur canapé en fermant les yeux, et soudain le temps s’arrête. Je veux créer ces petits outils qui mettent du love entre les gens.