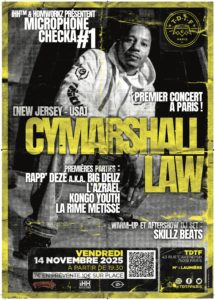iHH™ ARCHIVES : Interview rétrospective de Mobb Deep
Le 20 juin dernier, la galaxie hip-hop s’est trouvée endeuillée par la mort d’un de ses plus grands représentants, cofondateur d’un groupe à l’influence insondable. Faute de place, nous n’avons pas pu lui rendre l’hommage qui lui est dû dans notre prochain numéro, en kiosques le 19 septembre. Nous publions donc ici une longue interview de Prodigy en compagnie de son infernal acolyte Havoc, parue pour la première fois en 2014 dans l’ancienne formule d’International Hip-hop Magazine. Nous revenions longuement avec eux sur leur riche carrière en duo, à l’occasion de la sortie de leur huitième album commun, « The Infamous Mobb Deep ». Rest In Powa, P.

Interview et traduction : Yann CHERRUAULT
New York, c’est avant tout un état d’esprit. Quoi qu’on ait pu créer, c’est en fait un son de New York qu’on a sorti.
Pour commencer, revenons rapidement à la genèse de Mobb Deep. Comment votre machine à classiques s’est-elle mise en route ? Comment vous êtes-vous rencontrés à Queensbridge ?
PRODIGY : On avait un pote en commun au lycée : Black. C’est lui qui nous a permis de nous rencontrer. J’étais en cours de photo avec Black et il n’arrêtait pas de me bassiner au sujet de Havoc. Il me disait sans cesse que je devais absolument rencontrer ce gars qui rappait aussi, et, pour se foutre de moi, il rajoutait qu’on irait bien ensemble, parce qu’on était aussi petit l’un que l’autre [rires]. Black disait qu’on pouvait unir nos forces pour faire un groupe. Il avait raison, et c’est ce qu’on a fini par faire.
HAVOC : Prodigy était un niveau en dessous de moi, mais je me souviens bien de lui avec de grosses chaînes en or dans la cour. Je savais qu’il rappait, comme moi. On m’en avait parlé en bien, ça a favorisé les choses.
Vous étiez tous les deux branchés rap hardcore ou vous vous intéressiez à toutes les formes que prenait déjà le rap aux USA ?
P : En fait, on était un peu dans tous les styles. Hav’ avait déjà un style affirmé, hérité du son hardcore de Queensbridge… Quant à moi, j’étais toujours en apprentissage, je me cherchais encore.
H : Mais clairement, pour ce qui est du son, notre préférence allait dès le début vers ce qui était le plus street. À Queensbridge, il y avait évidemment des pointures comme tous ceux qui gravitaient autour de Marley Marl, mais on avait une passion commune pour des gars comme L.L. Cool J, Run-D.M.C. ou Schoolly D…
Tu viens de citer Marley Marl et d’évoquer son fameux collectif, le Juice Crew [MC Shan, Roxanne Shanté, Biz Markie, Big Daddy Kane, Masta Ace, Kool G Rap, Tragedy Khadafi, etc. – NDLR]. Ça a quand même dû sacrément influencer votre style au départ, non ?
P : On ne peut pas nier cette influence. C’est clair. Mais au-delà de ça, c’est New York tout entier qui nous a marqués de façon indélébile. Cette période, la fin des années 80 et le début des années 90, était dingue. Il y avait des trucs géniaux qui sortaient tous les jours, de tous les quartiers. La ville transpirait le hip-hop par tous ses pores.
Vous faites vos premiers pas en duo sous le nom de Poetical Prophets avec un son plutôt jazzy [le titre « Flavor For The Non Believes » – NDLR], on retrouve Prodigy sur la bande-originale du film « Boyz-N-The Hood » au côté du groupe de R&B Hi-Five… Et enfin, vous accédez à la cour des grands par l’entremise du puissant label Island/4th & Broadway pour lequel vous ne livrez qu’un album : « Juvenile Hell » en 1992. Un an plus tard, Island vous vire. Vous gardez quand même un bon souvenir de ce coup d’essai plus que mitigé ?
H : On s’en est remis. Cet album avec 4th & Broadway, ça nous a permis d’apprendre sur le tas et ça reste au final de bons souvenirs. C’est notre premier contrat avec une maison de disques et à cette époque, on ne captait pas grand-chose au business. On a beaucoup appris de cet échec, et sans doute que sans ça, on n’aurait jamais fait ce que nous avons réalisé à partir de l’album « The Infamous ». On s’est servis de cette déconvenue pour nous remettre en question et hausser le niveau.
Potentiellement, « Juvenile Hell » comportait pas mal d’atouts pour donner vie d’entrée à un petit classique. On retrouvait des productions de vous deux (cinq instrus signés Havoc, deux de Prodigy) mais aussi de Large Professor, DJ Premier, de Kerwin Young et Paul Shabazz du Bomb Squad de Public Enemy… Pour une raison qui m’échappe, la mayonnaise ne prend pas. Où est-ce que ça coince ?
P : On tâtonnait encore. Clairement. On était encore en train d’apprendre, de construire ce que nous avons atteint 2-3 ans plus tard. Havoc et moi commencions la composition d’instrus, on n’était pas encore carrés pour les textes et on avait manifestement quelques difficultés à bien structurer nos morceaux [rires].
Une des principales raisons pour lesquelles on a rapatrié chez nous toute la composition musicale, c’est que les enculés que l’on contactait pour des musiques nous demandaient des sommes ahurissantes !
Après la cruelle désillusion d’un premier album raté, comment avez-vous fait pour rebondir, pour repenser totalement la formule Mobb Deep ?
P : On avait clairement la volonté de revenir encore meilleurs. On avait parfaitement compris que « Juvenile Hell » n’avait pas convaincu les amateurs de hip-hop. On a pris du recul sur ce qu’on avait fait et on a vite compris. Ça nous a percutés en pleine poire. On a vraiment pris conscience qu’on avait merdé et on a repris le chemin des studios pour repenser totalement notre formule.
H : Pour être direct, on avait parfaitement reçu le message qu’il fallait qu’on soit amplement meilleurs pour nos projets suivants [rires] !
Pour « The Infamous », votre 2nd album et premier classique, vous abandonnez quasiment tous les contributeurs extérieurs pour la musique et vous le créez en quasi-autarcie, seulement épaulés par Q-Tip de A Tribe Called Quest [sous le pseudo The Abstract – NDLR], Schott Free et Matt Life du label Loud sur une poignée de morceaux. Est-ce que ça a été plus simple pour obtenir ce que vous recherchiez ?
H : En fait, une des principales raisons pour lesquelles on a rapatrié chez nous toute la composition musicale, c’est que les enculés que l’on contactait pour des musiques nous demandaient des sommes ahurissantes [rires]. Pour un album, ça aurait avoisiné le million de dollars ! On n’avait évidemment pas cette somme à mettre dans des instrus alors on s’y est pris autrement et on s’est mis à composer dans notre studio. La grand-mère de P’ nous a acheté du matériel et on s’est attelé à créer nos propres musiques, de façon bien plus poussée que sur « Juvenile Hell ». On a cherché des samples dans tous les disques auxquels on avait accès, idem pour les éléments de batteries pour nos beats. Comme des grands [rires] !
Et comment avez-vous appris à manipuler samplers, boîtes à rythmes et autres équipements de home studio ? Un mentor vous a prodigué les fondamentaux ?
P : On a appris sur le tas…
H : Oui, on s’est mis à bricoler tout cet électronique tout seuls. On a tenté de se souvenir de quelques trucs qu’on avait vu faire par d’autres en studio, notamment Large Professor que j’ai pas mal observé… C’est venu comme ça, on n’a d’ailleurs jamais lu les notices [rires] !
P : Ça n’a pas été facile, il faut bien l’admettre. Mais on y est parvenus finalement assez vite.
H : On appelle ça l’ingénierie inversée ! On démonte tout et on reconstruit entièrement en partant du vrac [rires].
Havoc, tu bossais à l’époque sur une des premières MPC [série mythique de samplers créés par Akai et Roger Linn – NDLR], c’est bien ça ?
H : Oui, une MPC60. J’avais aussi un EPS 16+ [un clavier/sampler de chez Ensoniq – NDLR], le tout connecté à une petite table de mixage 16 pistes…
Vous vous souvenez avec précision du jour où vous avez enfin abouti au son qui deviendra votre marque de fabrique ? Est-ce que c’est sur un morceau en particulier que la sauce a pris ?
H : Tu sais, New York, c’est avant tout un état d’esprit. Quoi qu’on ait pu créer, c’est en fait un son de New York qu’on a sorti. On ne pouvait pas y déroger. Il y avait souvent du monde au studio, mais c’est la plupart du temps au calme que je pondais les meilleurs trucs. Je ne me souviens plus vraiment des dates, mais quand la structure d’un morceau comme « Shook Ones » a pris forme, je me rappelle que les réactions étaient sacrément enthousiastes et encourageantes.
Tous les samples qui ont fait notre identité sonore viennent de nos collections familiales de vinyles !
Pour ce son renfrogné et menaçant qui a fait le triomphe de « The Inhamous » et de « Hell On Earth », vos 2e et 3e albums : y a-t-il des disques particuliers que vous ayez massivement utilisés comme banques de samples ?
H : On s’est bien servis dans les vinyles du grand-père de Prodigy [Budd Johnson, un grand jazzman actif dès le début des années 30 – NDLR]. J’ai également puisé dans les disques de mon père. Tous les samples qui ont fait notre identité sonore viennent de nos collections familiales de vinyles [rires].
P : On se faisait d’ailleurs engueuler parce qu’on les accaparait et qu’on mettait parfois des plombes à les ramener !
Dans la première moitié des années 90, il était bien plus facile qu’aujourd’hui d’utiliser des samples sans se ruiner, non ?
P : On puisait surtout dans les artistes et les morceaux obscurs. On en extrayait de petits samples et personne ne détectait vraiment où on avait ponctionné tel ou tel échantillonnage. Ça n’était pas comme si on utilisait une séquence complète. On retaillait tout ça en petits trucs et on assemblait l’ensemble comme des ingrédients dans une cuisine. Pour répondre à ta question, c’était dans l’absolu plus simple, mais notre technique de création musicale nous évitait d’être dans les radars des ayants droit et des cabinets d’avocats qui commençaient à faire fortune avec ça.
Le grand tournant de votre carrière, après le flop de l’album chez Island, c’est évidemment votre signature avec le label Loud dans lequel vous ramène DJ Stretch Armstrong. Est-ce qu’être signés avec ce qui était à l’époque un jeune label vous a offert le cadre idéal pour exprimer votre créativité ?
H : Carrément. Steve Rifkind [Le fondateur des labels Loud et SRC Record –NDLR] nous a offert une entière liberté. Il savait ce qu’on voulait faire, on avait carte blanche. C’est le meilleur deal qu’il pouvait nous proposer.
P : C’est clair. Grand merci à lui, comme à Schott Free et Matty C qui ont aussi contribué à ce que notre connexion avec Loud se passe bien.
Vous livrez donc coup sur coup deux classiques : « The Infamous » et « Hell On Earth ». Et puis vous optez pour une approche un peu plus consensuelle avec « Murda Muzik » et sa dizaine d’invités qui cartonne en terme de ventes [plus de 2 millions à ce jour – NDLR] puis avec « Infamy » où beaucoup de fans ne se retrouvent pas. Comment voyez vous aujourd’hui ces deux transitions ?
P : Après « Hell On Earth », on sort « Murda Muzik » qui n’est pas du tout un album tout public et sympa. Côté ambiance, c’est le plus lugubre qu’on ait sorti [rires]. Le succès de nos deux précédents albums nous ont permis de mettre beaucoup de pognon dans celui-ci, d’inviter plein de gens [Nas, Lil’ Kim, Cormega, Big Noyd, Kool G. Rap, 8Ball, Raekwon, etc. – NDLR], d’enregistrer entre New York et Miami… On s’est vraiment fait plaisir…
Avec « Infamy », la machine se grippe manifestement. Le single avec 112 écorne pas mal votre image…
P : Non, je ne te rejoins pas vraiment là-dessus… Il y a effectivement ce morceau avec 112 [« Hey Luv (Anything) » – NDLR] qu’on a invitées parce qu’on aimait bien ce qu’elles faisaient. Après, le morceau parle de chourer les nanas qui sont avec d’autres gars. Ça n’est pas un morceau super sympa. C’est même plutôt agressif [rires]. Quand tu te ballades dans la rue et que des lascars repartent avec ta nana après l’avoir embobinée, ça ne fait plaisir à personne [rires].
H : On ne peut pas dire qu’on bifurque vers du rap grand public. On change la formule musicale et forcément, il y a des fans de la première heure qui ne s’y retrouvent pas.
Après les 3 albums classiques que sont « The Infamous », « Hell On Earth » et dans une moindre mesure « Murda Muzik », comment est-il possible de se réinventer pour usiner à nouveau un disque de référence ? Il doit y avoir une pression qui s’instaure ?
H : Non, ce n’est pas du tout un problème. Nous avons vieilli, nous avons mûri. Nous sommes beaucoup plus expérimentés et donc naturellement, automatiquement, on s’améliore. Pour certaines personnes, c’est compliqué. Pour nous, ça ne l’est pas. Aujourd’hui, quand vous écoutez notre nouvel album qui vient de sortir, ça s’entend. On reconnaît instantanément que c’est du Mobb Deep. On n’a pas essayé de travestir notre son. C’est nous, c’est le son Mobb Deep. On se souviendra de « The Infamous Mobb Deep » comme on se souvient de nos autres albums. Pour nous, au final, ce sont tous de bons albums. Depuis toutes ces années, on a maintenu une belle constance dans la qualité dont on est fiers.
Et diriez-vous que ce 8e album réussi l’est en partie parce qu’il est le résultat de tous les hauts et les bas par lesquels vous êtes passés durant votre carrière, et, notamment, les tensions parfois très vives qui ont pu envenimer vos relations l’an dernier ?
P : Oui, indiscutablement. Toute notre musique est alimentée par nos vies, que ce soit du bon ou du mauvais. Quand on crée des morceaux, on y met tout ce par quoi nous sommes passés.
H : Aujourd’hui, toutes ces embrouilles sont derrière nous. On avance tous les deux, comme au premier jour.
« The Infamous Mobb Deep » n’a finalement pas été plus compliqué à finaliser qu’un autre de vos album ? « Business As Usual » comme dirait EPMD ?
H : « Business As Usual », c’est exactement ça [rires].
Cette fois, pour la production, on retrouve évidemment des sons de Havoc ou du vieux complice The Alchemist, mais aussi des productions de !llmind, du canadien Boi-1da ou de l’anglais Beat Butcha. Comment faites-vous vos emplettes pour les instrus afin de conserver, avec un assemblage de différents producteurs, cette inimitable touche Mobb Deep ?
P : En grande partie, c’est Hav’ qui s’est chargé de la production [7 des 17 nouveaux morceaux – NDLR]. On a toujours une oreille attentive à ce que font les autres producteurs. C’est comme ça qu’on a découvert The Alchemist il y a 15 ans. Sur cet album, on a voulu collaborer avec !llmind, Boi1Da et quelques autres gars qui ont un son que l’on aime. Ce sont des échanges de bons procédés entre artistes qui s’apprécient mutuellement.
Depuis toutes ces années, on a maintenu une belle constance dans la qualité dont on est fiers.
On a évoqué The Alchemist. Depuis que vous faites des choses ensemble, il y a toujours une « alchimie« très particulière entre vous. Comment vous êtes-vous trouvés ?
P : On s’est rencontrés grâce à DJ Muggs de Cypress Hill. On avait des potes en commun et Muggs nous l’a présenté. On a toujours aimé travailler avec des producteurs différents. Comme avec Large Professor à nos débuts, que l’on évoquait il y a quelques minutes. Ou encore DJ Premier, pour ne citer que ceux-là.
Sur ce nouvel album, Snoop Dogg est présent sur le morceau « Get Down ». Il y a 19 ans, accompagné du Dogg Pound, il vous rendait furieux avec le morceau « New York, New York » auquel vous avez répliqué instantanément en compagnie de Capone-N-Noreaga et de Tragedy Khadafy en larguant « L.A., L.A. ». Maintenant que la hache de guerre est enterrée et que les années ont passé, quel regard portez-vous sur ces longs conflits irrationnels et mortifères entre certains MC‘s de la côte Est et d’autres de la côte Ouest qui ont envenimé le rap américain un long moment ?
H : Ces embrouilles pourries datent maintenant. C’est définitivement le passé. Quand les invectives étaient à leur paroxysme, les médias et pas mal de journalistes grossissaient le tableau, mettaient de l’huile sur le feu pour exacerber à son maximum la rivalité entre nos deux scènes et en ramasser les dividendes. C’étaient de véritables conneries qui ne se basaient généralement sur rien de solide… Heureusement, tout ça est derrière nous.
https://www.youtube.com/watch?v=IY1APzDNzh0
Sur cet album, il y a l’anglais Beat Butcha. De plus en plus souvent, on vous entend avec des compositeurs étrangers, européens notamment. Vous avez les oreilles souvent rivées ailleurs pour trouver de bons sons ?
H : Ça, ce sont les connexions de P’…
P : Oui. Pour Beat Butcha, je l’ai rencontré quand il a travaillé avec Tony Yayo et Lloyd Banks [du G-Unit – NDLR]. Il leur avait fait de bons sons et je leur avais demandé qui leur avait livré. C’est comme ça que je l’ai connu et qu’on a collaboré ensemble. D’abord pour moi en solo, puis sur ce nouveau projet de Mobb Deep. Peu importe l’origine de nos producteurs, le seul critère qui compte, c’est qu’ils soient bons.
Le second CD de « The Infamous Mobb Deep » offre des inédits ou des versions alternatives issus des sessions d’enregistrement de « The Infamous », en 1994-95. Contrairement à pas mal d’artistes comme Nas récemment, on n’a pas retrouvé ces raretés sur une réédition officielle de votre 2e album, mais vous avez pu les incorporer à votre nouvel album. Vous êtes propriétaires des masters ? Vous n’avez eu aucune autorisation à demander à Loud et son propriétaire, Sony Music ?
P : Non, on ne leur a rien demandé du tout. C’est notre musique, on en fait l’usage que l’on veut. Et puis au final, ça rend service à Sony puisqu’ils sont propriétaires de la majorité de notre back catalogue. Qu’on remette à la lumière des morceaux de cette période leur permettra d’en revendre un peu.
Aujourd’hui, regrettez-vous « Blood Money », l’album que vous avez enregistré il y a un peu plus de 8 ans pour le G-Unit de 50 Cent ? Au final, il aura été sans suite et peu apprécié…
H : Non, pas du tout. 50 Cent est du Queens et on a des potes en commun. C’est un fan de Mobb Deep et, quand il a été au sommet de sa gloire avec beaucoup de pouvoir décisionnaire, il a renvoyé l’ascenseur à des gens qu’il aimait, qui l’avaient influencé. C’est un gars cool et direct. On s’entend bien.
P : Quand il nous l’a proposé, on a été immédiatement partants. On ne voyait aucune raison de refuser la proposition, d’autant qu’on s’était faits cordialement virer de Jive/Sony quelques semaines avant. Tout s’est passé très vite. On a enchaîné les concerts, les clips, et on a naturellement terminé en studio pour un album. Ça a été une nouvelle façon de bosser et ça nous a fait expérimenter d’autres sphères du business.
Sur la version alternative de « Eye For An Eye » qui figure sur le 2nd CD de votre nouvel album, morceau qui figurait originellement sur votre 2e album de 1995, on retrouve une belle partie de Ghostface Killah qui ne figurait pas dans la version originale. Pour quelle raison avait-elle été coupée ?
H : Je ne me souviens absolument pas pourquoi la version de l’album ne contenait pas Ghostface… Tu t’en souviens, P’ ?
P : Aucune idée. Je ne sais pas qui a pris la décision, ni ne connais la raison… L’essentiel, c’est qu’on n’ait pas perdu cette version complète et qu’on soit en mesure de la proposer aujourd’hui parce que c’est un sacré morceau avec de sacrés MC’s.
Et il vous reste encore beaucoup de morceaux des sessions d’enregistrement des albums « The Infamous » et « Hell On Earth » ?
P : C’est une réserve infinie… On en a vraiment un paquet !
Vous avez des projets pour les sortir un jour ?
P : Avec le temps, tout sortira. On attend les bonnes conditions pour les commercialiser.
Il existe un son Mobb Deep.
C’est la seule certitude !
Sony, le propriétaire du label Loud, ne vous a jamais demandé de contribuer à une version « DeLuxe » ou anniversaire de « The Infamous » par exemple ?
P : Non. Sony s’est même permis de sortir un « Greatest Hits » sans même nous demander notre avis. Ils ont fait ça de leur côté. On n’avait rien à voir avec ça et on s’y serait pris autrement. Ils ne peuvent rien sortir d’intéressant sans notre aide. On est très attentifs à d’éventuelles velléités que Sony pourrait avoir de ressortir certains de nos albums. Si on n’a pas notre mot à dire, rien ne pourra se faire, c’est clair. Si des rééditions arrivent un jour, ça voudra dire qu’on est sérieusement impliqués dans le processus de choix des morceaux, des visuels et autres éléments inédits.
Via vos labels respectifs, vous avez des projets à venir ?
H : Du Mobb Deep, du Prodigy, du Havoc…
P : Il y aura aussi sans doute des albums collaboratifs et peut-être de nouveaux artistes qu’on poussera…
De votre point de vue, existe-t-il encore un son Queensbridge ou est-ce quelque chose qui s’est perdu, qui s’est uniformisé ?
H : Il existe un son Mobb Deep. C’est la seule certitude [rires] !
Quand vous étiez au sommet de votre notoriété, dans la seconde moitié des années 90, vous étiez sans cesse sollicités pour des featurings, pour des musiques, des apparitions à droite à gauche… Était-ce pesant pour votre créativité, car j’imagine qu’il était difficile de refuser des propositions financières alléchantes ?
P : On a été ultra sollicités pour des featurings. Il y a même des tonnes de choses qui ne sont jamais sorties. Avoir un morceau avec Mobb Deep, c’était super à la mode. On en enregistrait pour à peu près tout le monde, et parfois ça restait dans les placards. À cette époque, on ne disait non à presque personne : que ce soit pour un album, un single, une mixtape, avec ou sans pognon… On refusait de temps en temps quand il n’y avait pas un kopeck et que l’artiste ou le morceau ne nous disaient rien de bon. Mais si on aimait bien le morceau, on le faisait gratos.
Et toi Havoc, quand on te commandait des instrus ? Il t’arrivait de refuser des demandes pour ne pas entamer ta créativité ou garder le meilleur pour vos morceaux ?
H : Je n’ai pas refusé souvent. Si les demandeurs avaient des arguments sonnants et trébuchants, j’étais leur homme. Après, je fournissais selon mon état d’esprit du moment. Je n’avais pas une banque de musiques dans laquelle les gens pouvaient choisir des instrus. Je fournissais ce que j’étais capable de confectionner sur le moment. Frais du jour ! D’un jour à l’autre, ça pouvait être très différent.
P : En fonction du demandeur et du moment, ça pouvait parfois être assez délicat. Il y a des jours où tu ne le sens pas et où le résultat n’est franchement pas glorieux [rires]… Mais à chaque fois, on donnait le meilleur qu’on pouvait. C’était la loterie.
Quand vous contemplez votre dense discographie, avez-vous un morceau ou un album fétiche ?
H : La question est complexe. Mais il est difficile de ne pas citer « Shook Ones » [rires].
P : Il y a clairement « Survival Of The Fittest », « Shook Ones »… Il est difficile de les hiérarchiser. Ce sont toutes des chansons de Mobb Deep !
2014 : « The Infamous Mobb Deep » (Infamous Records/RED/Sony)
2011 : « Black Cocaine » (Infamous Records/RED/Sony)
2009 : « The Safe Is Cracked » (Siccness)
2006 : « Blood Money » (Infamous Records/G-Unit/Interscope/Universal)
2004 : « Amerikaz Nightmare » (Infamous Records/Jive/Sony)
2003 : « Free Agents: The Murda Mixtape » (Infamous Records/Landspeed)
2001 : « Infamy » (Loud/Columbia/Sony)
1999 : « Murda Muzik » (Loud/Columbia/Sony)
1996 : « Hell On Earth » (Loud/RCA/Sony)
1995 : « The Infamous » (Loud/RCA/Sony)
1993 : « Juvenile Hell » (4th & Broadway/Island/Universal)